Index:
 LA
VISION EN RELIEF
LA
VISION EN RELIEF 
I L’œil : un organe complexe
A) Schéma de l’œil
Chacun des deux yeux est abrité dans une orbite, cavité creusée dans le squelette de la face. L’œil, ou globe oculaire, est une structure sphérique d’environ 2,5 cm de diamètre. Sa paroi est composée de trois couches de tissus concentriques. La couche périphérique est une enveloppe protectrice appelée couche scléro-cornéenne. Dans sa partie postérieure, elle est constituée de la sclérotique (ou sclère), de couleur blanche, qui recouvre environ les cinq sixièmes de la surface de l’œil. Dans sa partie antérieure, la couche périphérique est constituée d’une sorte de renflement en forme de hublot transparent, la cornée. La couche moyenne de la paroi de l’œil, l’uvée, est elle aussi divisée en plusieurs éléments, essentiellement la choroïde en arrière et l’iris en avant. La choroïde, riche en vaisseaux et nourricière, est appliquée contre la sclérotique et tapisse les trois cinquièmes postérieurs du globe oculaire. Quant à l’iris, c’est un petit disque pigmenté, contenant du tissu musculaire dans son épaisseur, percé en son centre d’un orifice de diamètre variable, la pupille, et placé verticalement en arrière de la cornée.
La couche la plus profonde de la paroi oculaire est la rétine. Elle tapisse toute l’uvée, mais n’est sensible à la lumière que dans sa partie postérieure.
Derrière la cornée se trouve une chambre remplie d’un liquide clair et aqueux, l’humeur aqueuse, qui sépare la cornée du cristallin. Ce dernier est une lentille plus ou moins aplatie constituée d’un grand nombre de fibres transparentes disposées en couches. Il est relié par des ligaments au muscle ciliaire, qui forme un anneau à la jonction de l’iris et de la choroïde. Ce muscle, en étirant le cristallin ou en le rendant presque sphérique, modifie sa distance focale.
Derrière le cristallin, on trouve le corps vitré, rempli d’une substance gélatineuse transparente, l’humeur vitrée. La pression de l’humeur aqueuse et de l’humeur vitrée maintient constantes la forme et la consistance du globe oculaire.
De nombreuses structures contribuent à la protection de l’œil (paupières et glandes lacrymales).
B) L’accommodation
L’accommodation est la capacité de l'oeil à voir nettement des objets à des distances différentes grâce à la déformation du cristallin.
Cette déformation du cristallin se fait grâce aux muscles ciliaires situés à chaque extrémité de ce dernier. Quand l’objet se rapproche de l’œil, celui-ci subit une double pression musculaire verticale élargissant le cristallin latéralement. Enfin quand l’objet s’éloigne les muscles se relâchent jusqu’à ce que l’œil n’ait plus besoin d’accommoder et le cristallin reprend alors sa forme initiale.
Le cristallin n’a subi aucune transformation donc l’image formée est floue du fait qu’il n’y a pas d’accommodation.
Les muscles ciliaires se contractent, le cristallin s’épaissit, l’image est donc nette.
Ce principe est identique lorsque l’objet s’éloigne jusqu'à ce qu’il n’y ait plus besoin d’accommoder. Dès lors les muscles se relâchent complètement et le cristallin est au repos.
L’image se forme à l’envers par rapport à l’objet au fond de l’œil sur la rétine. D’ailleurs le schéma de principe en optique le prouve.
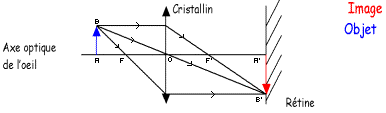
|
Principes d’optiques : Une lentille est caractérisée par son centre optique O, son axe optique et ses foyers objet F et image F’. La distance f = OF = OF’ est appelé la distance focale ; elle s’exprime en mètre. On définit la vergence C par : C = 1/f avec f en mètre. C s’exprime en dioptrie. ·La position
d’un point image conjugué d’un point objet peut être obtenue par construction
en appliquant trois règles : 1
Un
rayon incident passant par le centre optique n’est pas dévié. 2
Un
rayon incident parallèle à l’axe émerge en passant par le foyer image F’. 3
Un
rayon incident passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l’axe. Formule de conjugaison : 1/OA’ = 1/OF’ + 1/OA |
Ensuite grâce à l ‘accommodation, l’image arrive nette sur la rétine. C’est enfin le cerveau qui permettra le rétablissement de l’image de telle sorte qu’à la fin de toutes ces analyses l’image soit aussi droite que l’objet.
En conclusion, l’œil donne d’un objet une image renversée. Pour un œil emmétrope (œil normal), tous les rayons venant d’un objet situé à l’infini, c’est-à-dire au-delà de 5 à 6 mètres, arrivent parallèlement à l’axe de l’œil pour former sur la rétine une image inversée. On peut comparer l’œil à une lentille convergente d’une puissance de 60 dioptries dont le foyer principal serait sur la tache jaune ou fovéa et dont la distance focale serait de 15,7mm.
Avant d’atteindre la rétine, les rayons lumineux traversent les milieux transparents de l’œil, c’est-à-dire, successivement, la cornée, l’humeur aqueuse, le cristallin et l’humeur vitrée. Au cours de ce trajet, la cornée et le cristallin leur font subir une réfraction (un changement de direction) qui les fait converger et former une image sur la rétine. Le pouvoir de réfraction spontanée est tel que, pour la vision de loin (au-delà de 5 m environ), l’image tombe exactement sur la rétine. Quand l’objet se rapproche, si l’œil gardait ses caractéristiques optiques, l’image reculerait et deviendrait de plus en plus floue. Mais le cristallin s’arrondit progressivement sous l’action du muscle ciliaire, ce qui augmente la convergence des rayons et maintient l’image sur la rétine (voir optique). Ce processus est appelé accommodation. Il existe une distance limite (le punctum proximum) au-dessous de laquelle il n’est plus possible de voir net, l’accommodation ayant atteint son maximum. On observe une augmentation naturelle de cette distance avec l’âge : environ 6 cm chez le jeune enfant, une quinzaine de cm à trente ans, 40 cm à cinquante ans, 1 m à soixante-dix ans.
C) La rétine : les cellules réceptives de la lumière
La rétine est une membrane qui tapisse la face interne de l’oeil et qui contient les cellules permettant aux rayons lumineux d’être captés puis transformés en influx nerveux pour gagner le cerveau.Cette membrane très mince et transparente est en contact par sa face arrière avec la choroïde. Ce contact se fait grâce à un tissu appelé épithélium pigmentaire. La face antérieure de la rétine est en contact direct avec le corps vitré, qui est le gel remplissant la chambre postérieure de l’œil c’est-à-dire la partie la plus volumineuse du globe oculaire.
Quand les rayons lumineux entrent dans l’oeil en traversant la pupille, ils arrivent au niveau de la rétine et sont transformés en messages nerveux qui, par l’intermédiaire du nerf optique, rejoignent le cerveau. La papille, lieu de départ du nerf optique, permet à l’artère centrale de la rétine d’assurer la vascularisation de celle-ci en pénétrant dans le globe oculaire. Ensuite, elle se divise en deux branches (supérieure et inférieure) qui elles-mêmes se divisent en deux autres branches (temporale et nasale). Cette vascularisation est également assurée par un système veineux constitué par la tache centrale de la rétine. L’épithélium pigmentaire assure l’irrigation des cellules photoréceptrices constituant la rétine.
Trois couches superposées composent la rétine. De l’arrière vers l’avant de l’œil, on distingue : les cellules photoréceptrices composées de cônes et de bâtonnets, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires.
· Les cônes sont sensibles aux rayons lumineux et permettent la vision des couleurs. À l’endroit où l’acuité visuelle est maximale, la macula correspond à une dépression de la rétine, où le nombre de cônes est important. Dans la fovéa, qui est le centre de la macula, les cônes sont les seuls présents.
· Les bâtonnets, responsables de la vision en faible éclairage, sont des cellules sensibles à la quantité de lumière et à son intensité. On les retrouve un peu partout sur la rétine, leur fonction permet un agrandissement du champ visuel, appelé également vision périphérique. Les cellules bipolaires autorisent le passage de l’influx nerveux entre les cellules photo réceptrices et les cellules des ganglions nerveux
· Les cellules ganglionnaires permettent, par la réunion de leur prolongement, la constitution des fibres optiques au niveau de la papille aboutissant finalement au nerf optique.